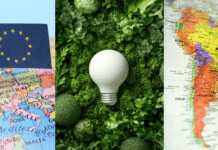Inde : les Dalits, entre oppression et ascension politique
Le système politique indien contemporain se caractérise par une interaction complexe entre l’État et les structures de pouvoir informelles. D’une part, l’État exerce un pouvoir à travers son administration dans une dynamique verticale centralisée à New Delhi. D’autre part, des modèles de pouvoir informels, issus de structures sociales locales, continuent d’influencer la vie politique et sociale. Ces réseaux de pouvoir informels s’appuient sur des dynamiques communautaires profondes, particulièrement les castes – ou varnas en sanskrit –, les clans et les familles (Borreguero, 2004). Contrairement au pouvoir étatique, fondé sur des institutions et des cadres juridiques, ces formes de domination sont ancrées dans des traditions sociales et des liens intergénérationnels, où l’autorité repose davantage sur le statut, les alliances et l’influence locale.
Cette dualité se manifeste particulièrement à travers le système des castes, qui structure en profondeur l’organisation sociale et politique indienne. Stratification millénaire, ce système divise et hiérarchise les individus, et l’ascension de caste y est presque impossible. En effet, certaines castes historiquement dominantes parviennent à conserver leur pouvoir et leur influence sur celles considérées comme inférieures, en particulier sur les dalits, anciennement désignés sous le terme d’« intouchables ».
Les Dalits constituent un groupe historiquement marginalisé, en grande partie en raison de leur exclusion du système de castes. Longtemps relégués aux tâches les plus ingrates et maintenus en dehors des sphères de pouvoir, ils ont néanmoins développé, au fil du temps, des formes de résistance et d’organisation politique. À travers cet article, nous analyserons leur place dans la société et la manière dont ils se sont progressivement imposés sur la scène politique. Nous nous interrogerons sur leur pouvoir politique actuel : dans quelle mesure sont-ils parvenus à s’affranchir des structures de domination traditionnelles ? Exercent-ils aujourd’hui une influence réelle sur la politique indienne ? Autant de questions qui nous permettront de comprendre les enjeux de la reconnaissance et de la représentation des Dalits dans l’Inde contemporaine.
I. Varna et Jati : Classe sociale et caste, entre origine et évolution
A- Contexte historique de l’émergence du système des castes
Le système des castes en Inde trouve ses origines dans une division sociale qui remonte à environ 1000 av. J.-C., période suivant l’arrivée des Aryens sur le sous-continent indien (Geo, 2021). Ces derniers, selon la théorie dominante, étaient un peuple indo-européen ayant migré vers l’Inde aux alentours de 1500 av. J.-C., introduisant des structures sociales et culturelles qui allaient profondément façonner la société indienne, notamment à travers l’émergence d’un système hiérarchisé et stratifié (Ghurye, 1969).
D’après le sociologue indien Ghurye (1969), les varnas (ou classes) seraient une adaptation locale du modèle social des Aryens. Ces derniers organisaient déjà leur société selon trois groupes distincts : les guerriers, les prêtres et le peuple (Geoconfluences, 2007). Lorsqu’ils s’établirent en Inde, ils consolidèrent une idéologie de pureté rituelle et d’exclusivité sociale afin de “préserver” leur identité face aux populations autochtones. Cette distinction sociale s’est progressivement ancrée dans les textes religieux. Certains des premiers écrits védiques, rédigés entre 1500 et 500 av. J.-C., justifient et renforcent cette hiérarchie (Gonda, 1975). Le Rig-Veda par exemple, l’un des textes fondateurs de l’hindouisme, établit notamment une opposition entre les Arya varna (les Aryens), placés en haut de l’échelle sociale, et les Dasa varna (les non-Aryens), relégués à un statut inférieur. Le terme sanskrit varna, qui signifie « couleur », semble ainsi refléter une classification fondée sur l’origine ethnique (Borreguero, 2004). Dans cette structure, les Aryens se sont attribué les trois premiers varnas, tandis que les populations autochtones et les métis furent relégués à la quatrième catégorie, les shudras.
Au fil du temps, cette organisation sociale s’est rigidifiée sous l’influence du brahmanisme et des textes sacrés hindous. Issu du védisme, le brahmanisme s’est développé en Inde entre 1500 et 500 av. J.-C. Il repose sur l’autorité des Védas, textes sacrés de l’hindouisme, et met en avant le rôle central des Brahmanes, la caste sacerdotale chargée des rites et du maintien de l’ordre cosmique (Dumont, 1966).
Les Védas définissent donc initialement quatre grandes classes sociales dans leur organisation de la société :
- Les Brahmanes (prêtres et savants), garants du savoir et des rites religieux (Asialyst, 2017).
- Les Kshatriyas (guerriers et dirigeants), responsables de la protection et du maintien de l’ordre (Geoconfluences, n.d.).
- Les Vaishyas (marchands et agriculteurs), acteurs économiques et commerciaux.
- Les Shudras (serviteurs), affectés aux tâches subalternes, notamment dans l’agriculture et le travail domestique.
Cette classification, qui reposait initialement sur des distinctions socio-professionnelles mais qui liait aussi l’origine ethnique, s’est progressivement transformée en un système héréditaire rigide, où chaque individu était assigné à une caste dès sa naissance. Cette rigidification a été décuplée par les textes religieux qui ont introduit des règles strictes de pureté rituelle et d’interdiction des contacts entre castes (Euronews, 2016).
En effet, l’hindouisme a renforcé cette hiérarchie sociale, en grande partie par le biais du concept de karma. Selon cette croyance, la position d’un individu dans la société était déterminée par les actions accomplies dans ses vies antérieures. Une personne née dans une caste inférieure était ainsi perçue comme victime de ses propres fautes passées, légitimant ainsi l’absence de mobilité sociale (Borreguero, 2004).
Si les varnas ont constitué la première grande division sociale en Inde, ils se sont progressivement imbriqués avec un autre système de stratification : les jatis, des sous-groupes plus nombreux et plus spécifiques. Cette superposition a encore renforcé la segmentation sociale, rendant les distinctions plus rigides et complexes (Borreguero, 2004).
Avec le temps, cette évolution a conduit à une société hautement hiérarchisée, où les règles de pureté rituelle dictaient strictement les interactions entre castes. Ces normes se traduisaient non seulement par des restrictions sur les contacts sociaux et professionnels, mais aussi par des dynamiques politiques structurantes. Par exemple, dans les États du nord de l’Inde, comme l’Uttar Pradesh, les tensions entre jatis ont façonné des stratégies électorales basées sur le clientélisme. Les partis politiques nouent ainsi des alliances avec les groupes dominants pour s’assurer de leur soutien électoral, un phénomène particulièrement visible lors des campagnes électorales. Les élites locales, qui exercent une influence décisive sur certaines régions, peuvent orienter leur soutien vers un candidat en échange de promesses concrètes, telles que des infrastructures publiques ou des avantages sociaux pour les membres de leurs castes (Jaffrelot & Kumar, 2013).
C’est dans ce contexte qu’émergea une catégorie sociale totalement en marge du système des castes : les Chandalas, plus tard appelés Dalits ou «Intouchables». Contrairement aux autres groupes, ils ne faisaient pas partie de la hiérarchie des varnas, ce qui les plaçait en dehors de l’ordre social établi. Considérés comme impurs, ils étaient relégués aux tâches les plus dégradantes, telles que la manipulation des cadavres, la gestion des déchets ou l’exécution des châtiments corporels. Leur statut d’exclus était si strict qu’ils devaient vivre en dehors des villages et n’avaient aucun droit de contact avec les membres des castes supérieures (Dumont, 1966).
Avec le temps, le terme Dalit, signifiant «opprimé» ou «écrasé», s’est imposé pour désigner ces communautés. À l’inverse, l’appellation «Intouchables», perçue comme stigmatisante, est aujourd’hui moins utilisée (Desai & Jain, 2014). Bien que la Constitution indienne ait officiellement aboli la discrimination fondée sur les castes, l’exclusion sociale et économique des Dalits demeure une réalité persistante dans l’Inde contemporaine.
B- Les Dalits en Inde : Entre Oppression Historique, Discrimination Systémique et Lutte pour l’Égalité»
Bien que la Constitution indienne ait aboli l’»intouchabilité» et que plusieurs lois aient été adoptées pour protéger les Dalits, leur oppression reste une réalité quotidienne. Malgré des quotas en faveur de leur accès à l’éducation et à l’emploi, les discriminations systémiques continuent de freiner leur intégration sociale et économique. Dans certaines régions, des enfants dalits sont encore relégués à des tâches subalternes à l’école, tandis que de nombreux adultes se heurtent à des refus d’embauche en raison de leur caste (Deshpande, 2011).
Par ailleurs, les Dalits engagés en politique ou dans des mouvements militants sont fréquemment la cible de représailles. Les défenseurs de leurs droits sont victimes de harcèlement judiciaire, et certains villages pratiquent encore des formes de boycott social, interdisant aux Dalits l’accès aux commerces ou aux ressources communes (Jaffrelot, 2020).
L’impunité entourant les violences à leur encontre reste un problème majeur. Dans les zones rurales, les agressions – y compris les violences sexuelles perpétrées par des membres de castes supérieures – sont souvent peu ou pas sanctionnées par la justice. En 2016, une étude a révélé que plus de 90 % des crimes contre les Dalits n’aboutissent pas à des condamnations, alimentant ainsi un climat de peur et de résignation (Manoharan, 2016).
Les discriminations et violences auxquelles sont confrontées les Dalits affectent de manière disproportionnée les femmes dalits, qui subissent une double oppression. En raison de leur statut d’« intouchables », ces femmes sont marginalisées, à la fois par une société patriarcale et par leur appartenance à une caste inférieure. Cette double marginalisation fait d’elles des cibles particulièrement vulnérables à diverses formes de violences, souvent ignorées ou minimisées par les autorités. Par exemple, si la violence sexuelle est un problème majeur en Inde, elle touche particulièrement les femmes dalits, dont l’exclusion sociale et la stigmatisation les exposent à un risque accru d’abus et d’exploitation. Selon l’International Dalit Solidarity Network (IDSN), moins de 2 % des cas de viols impliquant des femmes dalits aboutissent à des condamnations, contre environ 25 % des cas concernant des femmes de toutes castes en Inde (IDSN, 2019). Il convient de souligner que ces chiffres révèlent une défaillance significative du système judiciaire à rendre justice aux victimes de violences sexuelles, sans distinction de classes.
Les discriminations touchent également le monde du travail. Les Dalits occupent majoritairement des postes précaires et mal rémunérés dans le secteur informel. Bien que des lois existent pour garantir leurs droits, leur mise en application reste insuffisante, notamment dans les zones rurales (Jaffrelot, 2003). Malgré cette répression systémique, les mouvements dalits, appuyés par des intellectuels et des militants, parviennent progressivement à faire entendre leur lutte pour l’égalité et la justice.
II- Pouvoirs des dalits
A- Les Luttes Politiques et Sociales des Dalits : De l’Exclusion à la Représentation
Les Dalits, en raison de leur marginalisation historique dans le système des castes en Inde, ont donc été exclus des sphères politiques et sociales dominantes. Cette exclusion n’était pas seulement formelle, mais ancrée dans les pratiques sociales et économiques, les castes dominantes exerçant une influence importante, notamment dans les zones rurales où elles contrôlent la politique locale et les élections (Harriss-White, 2003). L’accès au vote et à la participation politique était également limité par des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, le manque d’éducation et les intimidations électorales, y compris la violence et les menaces directes des membres des castes supérieures (Kandiyoti, 1991). Des formes subtiles de discriminations électorales s’expriment par des pressions pour voter selon les préférences des castes dominantes. Ces dynamiques ont conduit à un isolement politique profond et ont rendu difficile l’établissement d’une influence politique autonome pour les Dalits.
Cependant, dès la fin du XIXe siècle, des figures comme B.R. Ambedkar ont milité activement pour la reconnaissance des droits des Dalits et leur émancipation sociale et politique. Cette aspiration à la dignité et à la justice s’est manifestée notamment avec la fondation du Bahujan Samaj Party (BSP) par Kanshi Ram en 1984, et son succès sous la direction de Mayawati, femme politique dalit. À travers des campagnes centrées sur la justice sociale, le BSP a su mobiliser les Dalits ainsi que d’autres castes marginalisées. L’une de ses plus grandes victoires a été l’ascension de Mayawati au poste de ministre en chef de l’Uttar Pradesh, l’un des États les plus peuplés de l’Inde, où le BSP a réussi à établir une représentation Dalit dans les cercles de pouvoir (Hearn, 2014).
Mayawati a illustré la possibilité pour une femme dalit d’accéder aux plus hautes instances politiques et d’influencer les politiques publiques. Elle a introduit des politiques d’inclusion, telles que des quotas pour les Dalits, qui ont favorisé une meilleure représentation de ces communautés dans les secteurs éducatifs et professionnels (Kaur, 2007). Malgré ces combats, elle reste une figure controversée, critiquée pour son style de gouvernance et certaines de ses décisions.
En dépit des avancées législatives et des efforts pour augmenter la représentation politique des Dalits, les mouvements des castes opprimées se heurtent encore à des défis complexes et persistants. Bien que des réformes telles que la Constitution de 1950, interdisant la discrimination fondée sur la caste, et l’introduction de quotas pour l’éducation et l’emploi aient ouvert des possibilités pour les Dalits, des tensions internes persistent au sein des communautés marginalisées. Une des difficultés majeures réside dans le fossé toujours présent entre les Dalits, entraînant des conflits d’intérêts et parfois une fragmentation du soutien politique (Harriss-White, 2003).
B- Diversité interne et défis à l’inclusion sociale et politique
Il existe une tendance à percevoir les Dalits comme un groupe homogène confronté aux mêmes injustices et exclusions sociales. Cependant, cette vision omet une réalité plus complexe : les Dalits sont eux-mêmes divisés en plusieurs jatis (castes) aux pratiques, aux intérêts et aux niveaux de richesse très variés. Au sein de cette communauté, certains Dalits vivent dans des conditions de grande pauvreté, tandis que d’autres ont acquis une certaine prospérité, en particulier dans des secteurs comme l’artisanat, la politique ou le commerce local. Par exemple, les Dalits issus de l’État du Tamil Nadu, historiquement plus impliqués dans l’artisanat traditionnel, ont une situation socio-économique et une perception sociale bien différente de ceux d’autres États comme l’Uttar Pradesh, où une plus grande partie de la population Dalit demeure dans une grande précarité (Geoconfluences, 2007).
Cette hétérogénéité sociale et économique complique les défis de l’unification politique et de la lutte collective des Dalits. En effet, bien que des mobilisations politiques aient permis de donner une voix au plus grand nombre, des tensions subsistent sur les priorités, les stratégies et la représentation de ces diverses catégories au sein du corps politique national. Dans ce cadre, les tensions entre Dalits se nourrissent de ces disparités internes (Deshpande, 2011).
De plus, l’hétérogénéité du territoire indien, tant sur le plan géographique qu’économique, ajoute un autre niveau de complexité aux défis rencontrés par les Dalits. Le pays, vaste et diversifié, présente des contextes sociaux, politiques et économiques très variés. Par exemple, les Dalits urbains, qui connaissent un certain niveau d’émancipation et d’intégration dans la vie politique et économique, peuvent être confrontés à des défis différents de ceux rencontrés par les Dalits ruraux, souvent davantage isolés et éloignés des structures d’assistance et de services publics (Deshpande, 2011). Cette diversité territoriale accentue également la manière dont les besoins et les revendications des Dalits sont entendus ou non dans les différentes régions. Dans certains États, des leaders Dalits parviennent à accéder à des postes de pouvoir, tandis que dans d’autres, le maintien du système de caste continue de nourrir de profondes divisions.
En parallèle, l’influence des autres castes s’accentue dans de nombreuses régions, particulièrement dans les zones rurales, renforçant les structures de pouvoir traditionnelles et compliquant la réalisation des objectifs d’inclusion pour les castes inférieures. Les violences casteistes et l’oppression sociale demeurent ancrées dans la réalité quotidienne de nombreux Dalits, dont l’accès à des opportunités économiques et sociales reste limité par des pratiques discriminatoires, parfois informelles mais souvent répandues (Manoharan, 2016). Par ailleurs, la culture de l’impunité face aux crimes commis contre les Dalits est un facteur aggravant, empêchant une justice équitable et renforçant le sentiment d’impuissance au sein de ces communautés.
Par conséquent, il est essentiel de reconnaître cette diversité interne au sein de cette classe pour pouvoir mieux comprendre les enjeux qui façonnent leur vie politique et sociale. Ainsi, des solutions stratégiques et des réformes législatives efficaces doivent tenir compte de l’ensemble de cette hétérogénéité, non seulement en offrant une meilleure représentation politique pour les Dalits, mais aussi en ajustant les politiques sociales et économiques pour traiter les disparités internes et les obstacles spécifiques auxquels ces différents groupes sont confrontés.
Conclusion :
Les Dalits, longtemps marginalisés, sont aujourd’hui à l’avant-garde du changement social et politique. Grâce à leurs luttes et aux réformes législatives, des avancées notables ont été réalisées dans la lutte contre la discrimination fondée sur la caste. Cependant, leur ascension politique reste freinée par des obstacles, notamment la non prise en compte de divisions internes au sein des communautés marginalisées. La pleine reconnaissance des Dalits dans les sphères politiques et économiques demeure un défi majeur. Pourtant, des personnalités comme Mayawati, les mouvements sociaux Dalits et les réformes constitutionnelles témoignent de l’évolution de cette lutte pour l’inclusion. Bien que le chemin vers une égalité réelle soit encore semé d’embûches, l’action des Dalits continue de transformer profondément la société indienne.
Les opinions exprimées dans cet article relèvent de la seule responsabilité de l’auteur et ne sont pas nécessairement celles de l’organisation.
Sources :
Asialyst. (2017, 31 octobre). Le système des castes en Inde en 10 points. Asialyst.
Borreguero, E. (2004). Hindú. Nacionalismo religioso y política en la India contemporánea. Los Libros de la Catarata
Chandra, B. (1995). The Making of Modern India: From 1857 to the 21st Century. Harcourt.
Deshpande, S. (2011). «Caste and Social Exclusion: Patterns of Discrimination.» Indian Sociological Review.
Deshpande, S. (2011). Contemporary India: A Sociological View. Penguin India.
Deshpande, A. (2011). The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India. Oxford University Press.
Desai, A., & Jain, D. (2014). «Hindu Nationalism and Dalits.»
Dharampal, G. (2006). «The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century.»
Dumont, L. (1966) – Homo Hierarchicus: Essai sur le système des castes
Euronews. (2016, 23 février). Cinq minutes pour comprendre le système des castes en Inde. Euronews.
Geo. (2021). Le système des castes en Inde.
Geoconfluences. (2007). Les castes en Inde, un millefeuille social entre mythes et réalités. Géoconfluences.
Geoconfluences. (n.d.). Jati. Géoconfluences.
Ghurye, G. S. (1969). Caste and race in India. Popular Prakashan
Gonda, J. (1975). The Hindu caste system: A socio-religious study. Oxford University Press.
Gutmann, R. (2009). Le paradoxe Mayawati : instrumentalisation identitaire et normalité indienne. Politique étrangère, Automne(3), 597-607. https://doi.org/10.3917/pe.093.0597
Harriss-White, B. (2003). India’s Market Women: Gender, Race, and the Politics of Gender in Postcolonial India. Journal of Asian Studies.
Hearn, J. (2014). «The Bahujan Samaj Party, Mayawati and Dalit Politics.» The Journal of Commonwealth & Comparative Politics.
ICCR India. (n.d.). Comprendre le système des castes en Inde. ICCR.
IDSN. (2019). The situation of Dalits in India: A human rights perspective. International Dalit Solidarity Network.
Infoinde. (n.d.). Le système des castes en Inde : les varna et jati. Infoinde.
International Journal of Science and Research. (2022). The Concept of the Puruṣārtha in the Present Perspective. IJSR.
Jaffrelot, C. (2003). India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Permanent Black.
Jaffrelot, C., & Kumar, R. (2013). «Caste, class, and clientelism: A political economy of everyday corruption in rural North India.» Modern Asian Studies, 47(5), 1372–1415. https://www.jstor.org/stable/4140822
Jaffrelot, C. (2020). La caste en Inde: Une histoire politique. Seuil.
Kandiyoti, D. (1991). Women and the State: The Politics of Feminism in India. Women’s Studies International Forum.
Kaur, R. (2007). Women and Social Change in North-East India: Exploring a Gendered Perspective. Nido Education.
Manoharan, M. (2016). «Dalit Women and Intersectional Violence.» Human Rights Watch.
Manoharan, K. (2016). The Marginalisation of Dalits in India: A Political Analysis. Oxford University Press.
Omvedt, G. (2006). Ambedkar and the Rebirth of India. Sage Publications.
OpenEdition Books. (n.d.). Le système indien des castes – Chapitre II. Varna et Jati. OpenEdition Books.
Pande, R. (2011). The Changing Face of Indian Politics: From 1947 to the Present. Permanent Black.
Shah, G. (2004). Caste and Democratic Politics in India. Cambridge University Press.
Shah, G. (2002). Dalits in India: A Social Movement Perspective. Sage Publications.
Times of India. (2018, 15 mai). Leading a balanced life through the pursuit of Purushartha. Times of India.
Wisdom Library. (n.d.). Purushartha: Significance and symbolism. Bibliothèque de la sagesse.